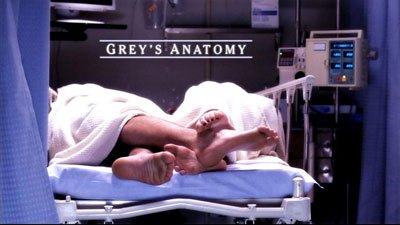Un grand merci à Emmanuelle Anizon. Elle m'a non seulement réveillée d'une terrible torpeur matinale, mais elle m'a aussi appris des choses importantes. Une journée et des pensées qui s'annonçaient nuageuses finissent par s'éclairer, ô miracle.
Un grand merci à Emmanuelle Anizon. Elle m'a non seulement réveillée d'une terrible torpeur matinale, mais elle m'a aussi appris des choses importantes. Une journée et des pensées qui s'annonçaient nuageuses finissent par s'éclairer, ô miracle.Potron-minet, j'ai couru sur le quai et suis rentrée in extremis dans le métro. Avant 8h, il est toujours vide. Je me suis affalée sur un siège, avec l'élégance d'un éléphant, ou d'un camionneur bourré. Ces derniers jours, pour éviter de rater ma station Censier-Daubenton (plongée dans un profond sommeil, bercée par les remous du wagon), je sors un journal – soit le Télérama, soit le Canard Enchaîné, papelard satyrique désopilant qui me vaut nombre de rires étouffés. Je suis donc tombée sur cet article de Manu. Très bonnes pages sur la déchéance de l'Université, avec un grand U, française. La Sorbonne ne serait plus ce qu'elle était. (Ou peut-être n'a-t-elle jamais vraiment justifié de ce rayonnement que l'on verrait jusqu'à Pékin...) Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi un tel sujet m'a réveillée ? Brusquement, j'étais presque fébrile et mes yeux grand ouverts suivaient mécaniquement le chemin des lignes. La conduite du texte était fort bien menée et frapperait n'importe qui, je crois.
Tout cela pour dire que les ruines de la Sorbonne sont aussi celles de mes illusions. J'en avais certes beaucoup (délit de jeunesse). En emménageant à Paris, il y a deux ans, j'avais des étoiles plein les yeux. Enfin ! Je me trouvais au coeur du monde (si, si), j'allais vivre dans cette belle ville lumière qui fait tant parler d'elle. Je rencontrerais des têtes nouvelles chaque jour, je verrais des choses totalement inédites que seules permettent les vraies métropoles. A chaque pas, un monument, une rue célèbre, du rococo ou que sais-je. J'y trouverais l'ouverture d'esprit, Le grand esprit, les cafés d'intellos, des cinémas dont un hublot fait office d'écran, et flânerais au gré des marches de Montmartre.

Caresser tous ces projets était une perte de temps. Paris ne réserve pas un accueil digne de sa beauté. Car Paris, c'est avant tout les parisiens. Jamais je n'avais croisé autant de visages immobiles, de regards dérobés. L'air est pollué et les airs sont vides. Cette ville est une jungle dont, comme dirait l'autre, la civilisation est le vernis. Un vernis de chez Tati, qui craquelle sans cesse et de toute part. Les seules bricoles, que j'oserais à peine appeler 'inédites', furent un incendie ; la chute d'un ouvrier du septième étage, et donc son corps mort et jaune ; ou un type battu et laissé à terre par des pingouins en colère. A ce prix là, je préfère ne plus "sortir le dimanche". Du reste, il n'y a pas moins touriste qu'un citadin, et c'est bien normal. Je ne visite absolument pas Paris. Toujours à faire le même chemin, toujours à courir dans les mêmes directions, sans trouver le temps de flâner, ni permettre au vent de me promener à son gré.
Le parisien est une foule. Il se déplace en grand nombre, comme une ombre (j'ose), déambule comme un fantôme. S'il lâche ses peines sur le trottoir, dans le filtre d'un mégot ou un crachat pollué, il ne lâche que rarement de l'argent dans la main noire des mendiants. Le parisien cède à Paris son habit le plus sordide, gardant portefeuille et bonne humeur bien au chaud, pour les dîners ou les mondanités. C'est un portrait bien sale, dont les traits sont grossis, mais Paris est une ville sale et peu fine. C'est ma plus grande désillusion, si l'on omet celle de l'homme bon.
 La Sorbonne représente à merveille cette Capitale 'déchue' qu'est mon Paname. Je suis déçue. Si l'on faisait un sondage dans mon coeur râleur, il serait alarmant. Une chute infernale de points, chaque jour. Voilà donc un résultat : 90% contre, 10% pour.
La Sorbonne représente à merveille cette Capitale 'déchue' qu'est mon Paname. Je suis déçue. Si l'on faisait un sondage dans mon coeur râleur, il serait alarmant. Une chute infernale de points, chaque jour. Voilà donc un résultat : 90% contre, 10% pour.L'Université reflèterait aussi parfaitement la Frânce, tiens. Un dédale de dossiers, une administration monstrueuse (dans les deux sens du terme), une organisation plutôt désastreuse, une prétention incroyable et enfin, chose qui définit bien notre pays : une Bureaucratie, avec un grand B.
Ces illusions sur ma vie d'étudiante étaient chères et sincères. Je ne parle pas des autres, ce serait un poème de dégoût. Je les vends au plus offrant, un gamin dont les mirettes brillent beaucoup trop, peut-être. Et l'oseille, je le garderai, à côté de ma bonne humeur.
Comment appeler tout cela ? L'ineffable désillusion provinciale (la banlieue entrerait dans le même cercle, c’est à dire, tout ce qui est hors du microcosme panamien), par exemple. Le désenchantement du petit oiseau sur la branche ; de la nana trop naïve, ou un peu trop con.